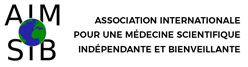Les nanoparticules de graphènes (oxyde de graphène, oxyde de graphène réduit et graphène quantum dots) : Propriétés, applications, toxicité et réglementations
Suite à de nombreuses réactions, nous avons pris le temps de relire et d’apporter quelques nuances à cet article. Nous restons ouverts à un débat contradictoire, car c’est en confrontant les différents arguments que l’on avance. Si des articles scientifiques permettent d’apporter des informations complémentaires, nous enrichirons notre article en conséquence.
Il a circulé récemment sur les réseaux sociaux des allégations sur la présence non déclarée de nanoparticules (NP) d’oxyde de graphène (GO) dans les vaccins à ARNm contre la COVID-19 (voir encadré). Certains sont même allés jusqu’à évoquer son utilisation (frauduleuse donc) pour une connexion des individus à la 5G et ont proposé des méthodes de détoxification au glutathion, N acétylcystéine (acides aminé précurseur du glutathion endogène), Zinc et autres [1]. Ricardo Delgado de La Quinta Columna [2] affirme avoir fait réaliser par des chercheurs espagnols des études observationnelles de doses de vaccin par microscopie optique et électronique, allant jusqu’à affirmer avoir dosé 747 ng de graphène. Certains sites vont jusqu’à affirmer que cette substance serait également présente dans les tests PCR, antigénique et les masques [3]. Mais il n’existe à ce jour aucune publication revue par des pairs.
Cet article tente de faire le point sur les propriétés physico chimiques, l’état de la recherche et les applications industrielles en cours, particulièrement dans les vaccins, la toxicité et la réglementation actuelle au sujet des nanoparticules d’oxyde de graphène afin de démêler le faux du vrai.
[cadre_bleu]
Composition du produit PFIZER (source : https://faqs.in.gov/hc/en-us/articles/360054190632-What-are-the-components-of-the-Pfizer-vaccine-shot-)
Ingredient actif
- ARNm modifié codant pour la glycoproteine virale Spike du SARS-CoV-2
Lipides
- (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis (ALC-3015)
- (2- hexyldecanoate),2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
- 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine (DPSC)
- cholesterol
Sels
- potassium chloride
- monobasic potassium phosphate
- sodium chloride
- basic sodium phosphate dihydrate
Autre
[/cadre_bleu]
1/ Propriétés chimiques et physiques de l’oxyde de grahène NP
Le GO est un isolant et un semi-conducteur électrique (cependant moins fort que le Graphène pur). Il s’agit d’une monocouche de carbone de structure hexagonale en nid d’abeille avec des groupes hydroxyde (OH) et carboxyliques COOH.
En raison de ses défauts dans la structure, des propriétés magnétiques locales ont été observées de différents types (ferromagnétique, paramagnétique, antiferromagnétique) du fait de ses propriétés semi-métalliques. Pour résumer, le magnétisme n’est pas une propriété inhérente du GO mais liée à la quantité de défauts de structures et son analyse physique est en cours.
Concernant le magnétisme des nanoparticules de ces composés, des recherches visent actuellement à régler deux problématiques pour activer leur magnétisme :
- la nécessité d’une consommation élevée d’énergie
- la contrainte d’un température ambiante (20°C) pour réussir à activer ce magnétisme
2/ Recherches et applications Industrielles
On distingue 3 structures : l’oxyde de graphène (GO), l’oxyde de graphène réduit (rGO) et le graphène quantum dots (GQD) qui sont des nanoparticules (donc de moins de 100 nm).
Les nanoparticules de GO sont actuellement étudiées et développées comme nano-supports pour une variété d’agents biologiquement actifs (biocatalyseurs, biocapteurs et médicaments).
De nombreuses applications utilisant des nanoparticules (NP) de GO sont envisagées :
- Environnementale : formant des complexes avec des polluants organiques / métalliques, il peut être utilisé comme dépolluant, pour purifier l’eau (salée) en améliorant l’hydrophilie des membranes de purification et en facilitant la photo-oxydation des molécules polluantes de l’eau.
- La production d’énergie par conversion de lipides en carburants par des lipases encapsulées.
- Médecine : les quantum dots (nanocristaux semi-conducteurs) – de graphène et de nano-composites magnétiques (Fe3O4) offrent un ensemble unique de propriétés optiques et magnétiques pour les futures applications énergétiques et médicales. Ils peuvent également être utilisés en imagerie médicale comme agent de contraste. De plus, les propriétés magnétiques des nanoparticules Fe3O4 en font un excellent agent de contraste pour les applications IRM. Ils montrent également une excellente réponse à la luminescence lorsqu’ils sont exposés à la lumière UV, entraînant une émission de lumière visible.
Les GO peuvent être utilisés pour faciliter la pénétration et l’absorption d’anticorps, d’enzyme, des médicaments, des protéines. Cependant des limitations à l’usage et l’application des nanoparticules magnétiques telle que l’agrégation et la précipitation à l’intérieur des vaisseaux sanguins, peuvent entraîner de graves conséquences. Enfin il y a des applications potentielles en thérapies anticancéreuses par ciblage actif de cellules tumorales ou ciblage passif quand des NP chargées positivement s’accumulent au niveau des sites tumoraux en raison des fuites vasculaires et de la faiblesse du système immunitaire fonctionnel de la région. Toutes ces applications n’ont pas encore abouti à des applications commerciales concrètes.
3/ La nanotechnologie et les vaccins à base d’ARNm basés sur le SARS-CoV-2
Les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna utilisent un ARNm de synthèse protégé par une bicouche lipidique, elle-même constituée de nanoparticules lipidiques (McGill COVID19 Vaccine Tracker Team, 2021) afin de permettre l’entrée de l’ARNm dans la cellule. Il n’y a pas de GO déclaré par le fabricant.
Pourtant, les NP GO et Graphène ont retenu l’attention en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et antivirales. Le graphène favorise l’absorption de médicaments et de macromolécules (acides nucléiques, protéines…). Gao et al., en 2020 [4] ont développé un nouveau vaccin contre le COVID-19 en utilisant la combinaison d’un nano adjuvant et d’oxyde de graphène. Cette étude, réalisée sur souris, montre que ce vaccin peut induire des anticorps anti-SARS-CoV-2 RBD à titre élevé neutralisant le SARS-CoV-2 chez la souris en 2 semaines. Les auteurs concluent sur l’efficacité du vaccin à induire une réponse immunitaire mais également sur la nécessité d’études complémentaires sur la dégradation du graphène in vivo afin de construire un vaccin répondant aux critères de sécurité et de biocompatibilité
Des équipes de recherches travaillant actuellement sur NP de GO-Polyethylène glycol- polyethyleneimine, dans le cadre du développement d’immunothérapies anticancéreuses, tentent de retarder leur phagocytose (absorption et destruction de molécules par certaines cellules immunitaires) afin de rendre possible leur utilisation dans de telles thérapies.
Un autre aspect limitant de son utilisation est la toxicité potentielle in vivo du graphène. Ce sujet de débat et le manque d’informations suffisantes pour autoriser légalement les applications humaines semblent sa commercialisation peu probable dans l’état actuel des connaissances. Ainsi, son instabilité et l’agrégation du graphène en solution sont un défi supplémentaire alors que la solution des médicaments et des vaccins a besoin de stabilité [5].
4/ Toxicité des nanoparticules (NP) d’oxyde de graphène (GO)
Le projet européen Graphene Flagship étudie la toxicité de ce matériau (environnemental, santé) du fait de l’utilisation prometteuse dans l’administration de médicaments, la bio-imagerie, l’ingénierie tissulaire, la biodétection [6]. Un rapport de 2016 de l’Agence suédoise KEMI fournit un état des lieux très complet en 2019 sur l’absorption et la biodistribution de NPs, étape cruciale avant la toxicité potentielle des NPs [7].
Leur toxicité est dépendante de la biodégradation qui dépend elle-même fortement du pourcentage d’oxygène, du type de groupes fonctionnels (comme des epoxy), des défauts, de la taille et du nombre de couches. Plusieurs mécanismes cellulaires de toxicité des nanomatériaux de GO ont été identifiés : le stress oxydatif (inflammation), dommages à l’ADN (impact de la réplication cellulaire), réponse inflammatoire ou encore la destruction cellulaire par différents mécanismes : apoptose, autophagie, nécrose.
Le GO serait dégradé par une enzyme (la myéloperoxydase) produite par des globules blancs (neutrophiles) arrivant sur un site d’infection.
Toxicité cutanée : Selon Wang et al, 2016 [8], la majorité des études existantes suggèrent que les graphène quantum dots (GQD) ont une toxicité in vivo et in vitro relativement faible et une excellente biocompatibilité, par rapport avec notamment l’oxyde de graphène (GO), les nanotubes de carbone et les semi-conducteurs conventionnels. Mais le profil de toxicité des GQD varie selon les tests et la production de GQD. Les GQD voient leur pénétration cutanée augmenter avec l’exposition aux UV ou si la barrière cutanée est détériorée. D’une manière générale l’absorption systémique dépend de nombreux facteurs comme la taille, la charge de surface, le revêtement des NP, l’agglomération des NP, la composition du milieu et son pH. D’une manière générale, par la voie cutanée, la voie de pénétration par les follicules pileux (cavité à la base du poil) serait considérable, surtout pour les petites NP inférieures à 20 nm.
En intramusculaire et en sous cutané chez la souris, les QD de carbone se diffusent rapidement depuis le point d’injection. Après 24h, il n’y a plus d’identification dans aucun organe, suggérant une élimination totale des nanoparticules de carbone. En injection sous-cutanée, ils se retrouvent dans les ganglions lymphatiques entraînant une importante réponse immunitaire rapide.
Administrées par voie intranasale, des NPs de polymères de carbone polyanhydre sont aussi rapidement dispersées. Certaines, hydrophobes, peuvent persister cependant dans le tissu pulmonaire. D’une manière générale, les NPs par voie intranasale, surtout quand elles sont très petites, traversent la muqueuse olfactive et sont véhiculées en quantité importante dans le bulbe olfactif et autres parties du cerveau.
Injectés directement dans le sang, les quantum dots (QD) se retrouvent principalement dans le foie, la rate et les reins, qui sont les organes de « détoxifications » et en faible quantité dans le cerveau (0.1%). D’une manière générale, injectées dans le sang, les NP, en fonction de leur taille et de leur charge, peuvent subir une adsorption ou une opsonisation (= liaison à un anticorps) par les protéines sériques. Cette opsonisation favorise sa clairance (la purification par cette voie dépend de la taille des particules : plus le diamètre est grand, plus la clairance est cependant ralentie). Les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins, forment une barrière semi-sélective selon la taille des nanoparticules : au niveau de l’endothélium vasculaire, des pores de 5nm permettent le passage des QD, ce qui fait qu’ils atteignent rapidement l’espace extracellulaire extravasculaire alors que les plus grandes >5nm restent plus longtemps dans la circulation sanguine où elles subissent une phagocytose et sont donc évacuées.
En résumé, les NP de Graphène (Go, G, GQD) sont d’autant plus toxiques que leur taille est grande (micron). Les groupements époxy du GO peuvent entraîner un stress oxydatif (inflammation) pouvant conduire à la mort cellulaire. Elles sont cependant plus facilement dégradées par des enzymes comme les peroxydases.
Des études visant à réduire leur toxicité en les liant à des polymères biocompatibles sont actuellement en cours. A l’heure actuelle, la toxicité du graphène est encore insuffisamment définie et seuls les effets aigus (court terme) et subaigu (moyen terme) ont été déterminés.
Le schéma de distribution des NP confirme que les molécules sont phagocytées et donc rapidement neutralisées. Cette distribution et leur accumulation/dégradation dépendent de la taille, la forme et la charge de surface des particules mais également de l’organe cible, le flux sanguin, le nombre de cellules phagocytaires.
5/ Réglementation
L’UE ne précise pas de consignes particulières concernant les nanomatériaux utilisées dans les dispositifs médicaux, il y a peu de détails dans le règlement 2017/74/CE mais d’autres Réglementations Européennes telles que REACH 1907/2006/CE (qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques) considèrent les propriétés et dangerosités propres aux nanomatériaux.
Il existe un guide du comité scientifique dédié aux risques émergents (SCENIHR) de 2015 qui précise certaines recommandations pour l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux des nanomatériaux. Ces risques sont principalement liés aux NP libres dans les dispositifs médicaux et la durée d’exposition ainsi que la nécessité d’étudier la distribution et la persistance dans des organes spécifiques.
L’oxyde de graphène (GO) n’est pas officiellement classifié selon le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage, CLP 1272/2008/CE. Il existe cependant une Valeur Limite Professionnelle de 3.6 mg/m3 par inhalation.
Il est à noter également, que les nanomatériaux de la famille du graphène ne sont pas approuvés par la FDA aux États-Unis pour la consommation humaine. Selon la FDA, le graphène, l’oxyde de graphène et l’oxyde de graphène réduit provoquent des effets toxiques à la fois in vitro et in vivo et leurs utilisations ne sont donc pas autorisées.
RETOUR à LA RUMEUR ….
La présence de l’oxyde de graphène dans le vaccin est née d’une observation au microscope électronique à transmission demandée par R. Delgado Martin au Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Ecole supérieure d’ingénieurs Univ. Almeria, Espagne). Il ne s’agit donc pas d’un travail de recherche revu par des pairs mais d’une commande privée. Ce dernier a rendu un rapport non publié dans une revue à comité de lecture. Il a comparé le résultat à un article de Choucair publié en 2009 dans Nature Nanotechnology [9] montrant une observation de graphène. La lecture de ces deux publications souligne deux points qui s’opposent à la présence supposée d’oxyde de graphène dans les vaccins à ARNm :
- La publication de référence (Choucair et al., 2009) montre une analyse en microscopie électronique de graphène obtenu par pyrolyse et non d’oxyde de graphène. L’obtention de l’échantillon par pyrolyse confirme que cette référence ne montre pas un oxyde de graphène.
- Cette analyse proposée par Delgado est basée sur des observations par diverses techniques et il est surprenant qu’elles n’aient pas été confirmées par une analyse chimique qui validerait le résultat et la substance observée dans l’échantillon étudié.
C’est d’autant plus surprenant qu’un brevet, intitulé « Vaccin recombinant nano-coronavirus prenant de l’oxyde de graphène comme vecteur » a été déposé par Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd depuis le 27 Septembre 2020 et n’a à ce jour pas été accepté [10].
CONCLUSION
Face à la crainte légitime qu’inspire actuellement le projet transhumaniste, il est compréhensible de s’interroger sur les intentions et applications possibles et souhaitables pour l’humanité. Cependant il faut bien distinguer les utilisations existantes, possibles et potentielles.
L’oxyde de graphène peut jouer un rôle de vecteur ou de ciblage comme le montrent certains projets de recherche biomédicale en cours. Mais, à ce jour, peut-on répondre de la manière la plus objective possible, à la question : est –il possible qu’il y ait de l’oxyde de graphène dans les vaccins et pourquoi y en aurait-il ?
Au regard de la réglementation, les études de toxicités des NP de l’oxyde de graphène sont encore insuffisantes pour permettre une application pratique dans le domaine des médicaments, des vaccins ou des dispositifs médicaux. Si des progrès certains sont à noter dans le domaine de leurs propriétés de surfaces pour améliorer leur biosolubilité et leur biocompatibilité, il reste encore trop de données manquantes en toxicité in vivo, mais aussi en cancérogénèse, mutagénèse et génotoxicité ainsi que dans la compréhension de la phagocytose dans les monocytes (foie, rate, ganglions lymphatiques). Ces données issues de tests standardisés sont nécessaires aux fins d’autorisation réglementaire et cela rend improbable l’usage actuel dans le domaine des vaccins, même si cela est envisagé. Par contre, la présence d’impuretés, même métalliques, reste possible.
Dans le cas des « vaccins » actuels contre la COVID-19, administrés en injection intramusculaire, l’élimination rapide par phagocytose des nanoparticules d’oxyde de graphène rend difficilement possible la thèse d’une administration frauduleuse en vue d’une connexion furtive à la 5G qui plus est. Il paraît plus probable que si une telle connexion était à envisager entre un serveur et un individu, elle se fera d’abord par des objets connectés portés de manière volontaire ou contrainte (smartphones), puis par une micropuce sous-cutanée implantée, mais pas via une injection systémique de NP dispersées censées s’accumuler dans un organe (cerveau, cœur…), compte tenu de leur élimination rapide que ce soit par réactions d’oxydation pour le GO ou par phagocytose pour le graphène. Par la voie systémique, l’utilisation à venir dans un avenir proche ne peut qu’être ponctuelle comme en imagerie ou en thérapie anticancéreuse par exemple.
BIBLIOGRAPHIE
[1] https://rumble.com/vkipvb-comment-degrader-loxyde-de-graphene-version-franaise.html
[2] https://www.henrymakow.com/upload_docs/4_5976673186836646447.pdf
[3] https://chemicalviolence.com/2021-07-14-spanish-study-pfizer-vaccine-toxic-graphene-oxide.html
[4] Gao A., Liang H., Shen Q., Zhou C., Chen X.M., Tian J., …Cui D. Designing a novel nano-vaccine against SARS-CoV-2. Nano Biomedicine and Engineering. 2020;12(4):321–324.
[5] Ghaemi F, Amiri A, Bajuri MY,Yuhana NY,Ferrara M, Role of different types of nanomaterials against diagnosis, prevention and therapy of COVID-19. Sustainable Cities and Society, 25 May 2021, 72:103046
[6] https://graphene-flagship.eu/
[7] https://www.kemi.dtu.dk/nyheder/2019/07/opening_the_door_to_hybrid_2d_materials?id=363e4fee-645b-42ba-8aa1-ce8ca23528e6
[8] S. Wang, I. S. Cole, and Q. Li, “The toxicity of graphene quantum dots,” RSC Advances, vol. 6, no. 92, pp. 89867–89878, 2016.
[9] Mohammad Choucair, Pall Thordarson and John A. Stride, 10.1038/NNANO.2008.365 “Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication, Feb 2009.
Uptake and biodistribution of nanoparticles – a review, Report 12/16, Swedish Chemicals Agency. Stockholm 2016
[10] Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier (depuis 27/9/2020) par Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd
https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en











 Figure 1 : Taux de décès dû à la COVID-19 par tranche d’âge en Corée du sud, Espagne, Chine et Italie
Figure 1 : Taux de décès dû à la COVID-19 par tranche d’âge en Corée du sud, Espagne, Chine et Italie