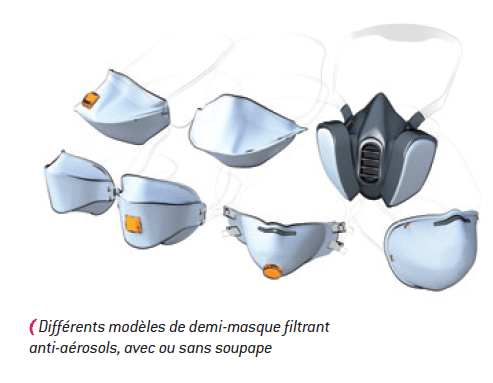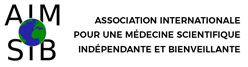1, 2, 3, 4, 5 doses et toujours rien chez des immunodéprimés … explication ?
[cadre_a_retenir]
A retenir
- L’activation rapide d’une réponse spécifique et efficace à une injection vaccinale nécessite un système immunitaire en bon état
- Quand un principe thérapeutique ne procure aucun bénéfice à une population cible, il est important d’essayer de comprendre pour rectifier la stratégie
- Tous les individus ne sont pas équivalents (âge, statut immunitaire, infections endémiques, comorbidité etc.) pour leur capacité à répondre de façon stéréotypée à une injection vaccinale
[/cadre_a_retenir]
Définition :
Immunodépression : Inhibition, d’un ou de plusieurs des composants des systèmes immunitaires innés ou adaptatifs, provoquée par une maladie (hémopathie, cancer…), une irradiation accidentelle ou induite intentionnellement par un traitement immunosuppresseur (dans le cadre par exemple du traitement du rejet d’une greffe ou celui d’une maladie auto-immune).
A-t-on confondu urgence et précipitation ?
Les injections de principes vaccinaux élaborés pour éduquer notre système immunitaire à réagir efficacement face à l’infection par le SARS-CoV-2, empêcher sa propagation dans la population générale et éviter le développement de la maladie COVID-19 ont débuté en janvier 2021 en France. Elles visaient pendant les premiers mois les populations classées comme étant les plus vulnérables, notamment selon un critère de l’âge. Mais, dès le mois de mai, conformément à un avis transmis un mois plus tôt par le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale (COSV), la Direction Générale de la Santé (DGS) publiait une note urgente à destination des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes indiquant que « l’injection d’une troisième dose de vaccin est nécessaire pour les personnes sévèrement immunodéprimées » [1].
Petit retour en arrière. A la suite des essais cliniques entamés par Pfizer, Moderna et Astra-Zeneca sur plus de 100 000 sujets volontaires, des autorisations temporaires ont été délivrées par les agences de santé à travers le monde pour l’injection de principes vaccinaux contre la COVID-19 sur des populations adultes. Parmi ces adultes, les personnes immunodéprimées et/ou recevant une chimiothérapie, une immunothérapie ou un traitement à base d’immunoglobulines ont néanmoins été exclues des essais cliniques. Cela n’a pas troublé un seul instant les agences gouvernementales de santé. La seule condition était que les principes vaccinaux n’incluent pas de virus vivants pour lesquels malheureusement les dangers sont largement documentés concernant les populations immunodéprimées. Ces sujets vulnérables, environ 300 000 en France, ont donc été ciblés très vite, sans aucune donnée médicale sur les effets des principes vaccinaux à ARN ou ADN. Au fur et à mesure du temps, les sujets immunodéprimés ont même été désignés comme cible prioritaire pour limiter la propagation du virus pathogène original et de ses variants successifs, au même titre que les personnes âgées de plus de 65 ans avec comorbidités. En effet, les cas cliniques se sont multipliés avec des indications d’apparitions inquiétantes de mutations du SARS-CoV-2 chez des sujets immunodéprimés. Il y aurait une forme d’évolution accélérée du virus qui profiterait d’un système immunitaire affaibli pour développer des stratégies d’échappement. Ces sujets immunodéprimés deviendraient alors des réservoirs susceptibles de générer des variants plus infectieux et plus virulents pour la population générale [2]. On a quand même eu l’idée lumineuse en mars 2021 d’évaluer, dans un essai observationnel, la réponse immune chez des patients traités en hématologie et immunodéprimés pour cause d’une maladie et/ou d’un traitement [3]. Cependant, sans attendre les résultats de ce genre d’études, l’état d’urgence décrété pour une expérimentation massive sur des personnes vulnérables pour lesquelles on n’aurait pas eu d’autres alternatives thérapeutiques se solde par un échec, en premier lieu pour les patients immunodéprimés.
Le 1er janvier 2022, le Journal du Dimanche relayait un appel au président Emmanuel Macron de 6 présidents d’association représentant des personnes immunodéprimées et l’exhortant à tout faire pour protéger les plus fragiles. « Monsieur le Président de la République, les personnes immunodéprimées sévères, qu’elles soient transplantées, dialysées, atteintes de certains cancers ou prenant certains traitements, sont actuellement en grand danger en raison de l’ampleur de la pandémie de Covid en France et de leur réponse nulle ou insuffisante à la vaccination. Dès à présent, elles représentent jusqu’à 30% des séjours en réanimation dans certains hôpitaux, alors qu’elles sont moins de 300.000 au total en France, et qu’elles ont d’ores-et-déjà reçu trois, quatre, voire cinq doses de vaccin [4]. «
Les témoignages se sont multipliés de patients immunodéprimés, et parfois de leurs soignants, constatant une vulnérabilité toujours présente face aux différentes formes du SARS-CoV-2, en dépit d’injections obstinées. Celles-ci devaient pourtant, officiellement, constituer l’arsenal le plus sûr et le plus efficace pour éradiquer une maladie émergente.
Que se passe-t-il donc ? Est-ce de la désinformation, une désinvolture vis-à-vis d’une population fragile, de l’ignorance ? A-t-on encore des choses à apprendre sur les mécanismes de stimulation d’une réponse immunitaire adaptative dans un environnement particulier, des sujets avec en permanence un frein empêchant d’appuyer sur la pédale de l’accélérateur de l’activation immunitaire induite par une stimulation antigénique ?
Comme souvent, faire preuve d’humilité face aux lacunes de nos connaissances au milieu de la complexité du vivant devrait être prodigué…comme une piqûre de rappel. Aussi, il est peut-être utile de se demander ce qui se passe exactement chez les sujets immunodéprimés après l’injection d’une formule à ARN ou ADN. Plus précisément à l’endroit même où, en théorie, nos meilleurs fantassins seraient formés à reconnaître, isoler et neutraliser la menace terroriste du SARS-CoV-2 : les ganglions lymphatiques drainant le site d’injection du principe vaccinal. C’est à cet endroit que, dans un compartiment dénommé centre germinal, des plasmocytes, des sortes d’usines à produire des anticorps, et des lymphocytes B mémoires sont fabriqués en masse. Cette fabrication est orchestrée par des lymphocytes T folliculaires auxiliaires. Ce processus est décrypté par la prestigieuse revue Cell dans son édition en ligne du 1er février 2022 [5]. Des investigateurs américains ont ainsi utilisé une technologie couplant guidage par de l’imagerie à ultra-sons et aspiration avec une aiguille fine pour évaluer la réponse dans les centres germinaux générée par la libération de principes vaccinaux à ARN à proximité d’un ganglion lymphatique. La population ciblée était constituée de 15 sujets sains (23 à 76 ans) et 13 transplantés rénaux sous traitement immunosuppresseur qui présentaient avant transplantation une réponse anticorps normale pour les vaccinations anti-tétanique, oreillons, rubéole et rougeole. Comme attendu, dès la primo-injection, il a bien été observé une forte induction de lymphocytes B activés contre la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2, et en particulier de la partie de la glycoprotéine (le domaine de fixation au récepteur) qui interagit avec le récepteur à la surface de nos cellules épithéliales afin de permettre l’internalisation du virus. Cette induction était présente au niveau de centres germinaux de ganglions drainant le site d’injection chez les sujets sains, un processus amplifié lors de la deuxième injection. Cette réponse de cellules B spécifiques du SARS-CoV-2 était également associée à une induction robuste de lymphocytes T folliculaires auxiliaires, de lymphocytes B mémoires et d’anticorps neutralisants. En revanche, de façon très contrastée, chez les transplantés rénaux, au niveau des centre germinaux équivalents de ceux examinés chez les sujets sains, il n’était détecté que très peu de cellules B mémoires dirigées contre le domaine de fixation au récepteur de la glycoprotéine spike, qu’une quantité infime de lymphocytes T folliculaires auxiliaires et une quasi-absence d’anticorps neutralisant. Cette étude montre ainsi que les individus recevant des médicaments immunosuppresseurs ne génèrent pas de réponse efficace au processus de vaccination au niveau des ganglions drainant le site d’injection. Une réponse vaccinale suboptimale chez des sujets transplantés recevant un traitement immunosuppresseur avait déjà été signalée dans le cas de la grippe A/H1N1 ou de l’hépatite B [6,7].
Finalement, la population ciblée d’emblée comme ayant le plus besoin de la vaccination anti-COVID-19 est sans doute celle pour laquelle le processus fonctionne le moins bien. Vous aurez beau faire toutes les améliorations de moteur et fournir le meilleur carburant à une voiture, si elle n’a qu’une seule roue, elle aura beaucoup de mal à avancer. Pendant ce temps, on continue d’obliger les populations qui en ont le moins besoin ou pas besoin du tout de recevoir des principes vaccinaux dirigés contre une forme disparue de SARS-CoV-2. Encore une fois, il semble que ce ne soit pas la science qui guide les décisions gouvernementales. Pourquoi ?
Références
[1] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_imd.pdf
[2] Corey L, Beyrer C, Cohen MS, Michael NL, Bedford T, Rolland M. SARS-CoV-2 Variants in Patients with Immunosuppression. N Engl J Med. 2021 Aug 5;385(6):562-566. doi: 10.1056/NEJMsb2104756. PMID: 34347959; PMCID: PMC8494465. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsb2104756
[3] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04805216
[5] https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00138-6
[6] Cowan M, Chon WJ, Desai A, Andrews S, Bai Y, Veguilla V, Katz JM, Josephson MA, Wilson PC, Sciammas R, Chong AS. Impact of immunosuppression on recall immune responses to influenza vaccination in stable renal transplant recipients. Transplantation. 2014 Apr 27;97(8):846-53. doi: 10.1097/01.TP.0000438024.10375.2d. PMID: 24366008; PMCID: PMC4843769. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24366008/
[7] Friedrich P, Sattler A, Müller K, Nienen M, Reinke P, Babel N. Comparing Humoral and Cellular Immune Response Against HBV Vaccine in Kidney Transplant Patients. Am J Transplant. 2015 Dec;15(12):3157-65. doi: 10.1111/ajt.13380. Epub 2015 Jul 2. PMID: 26137874. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajt.13380